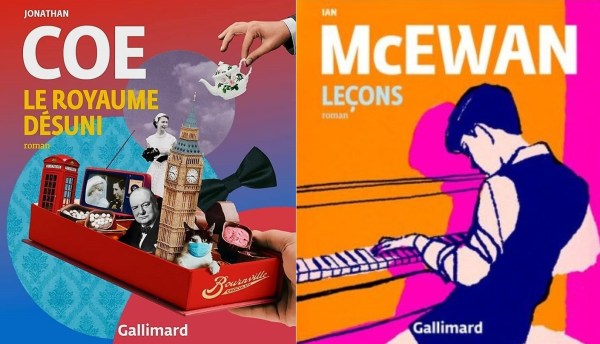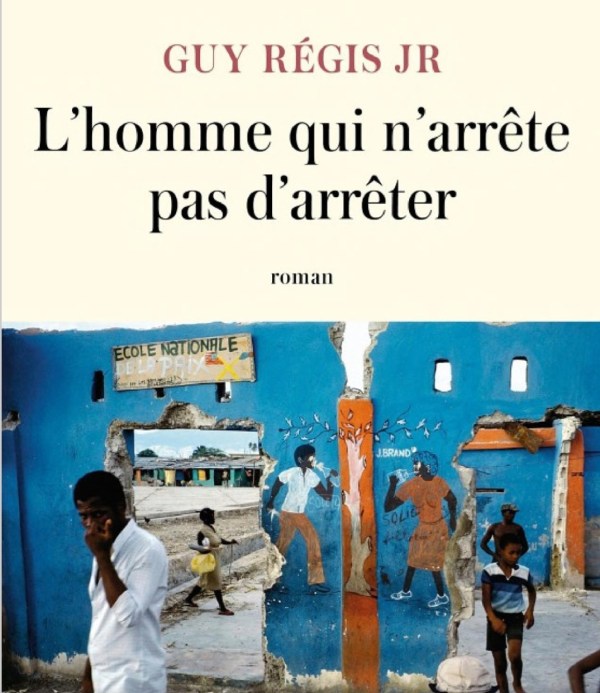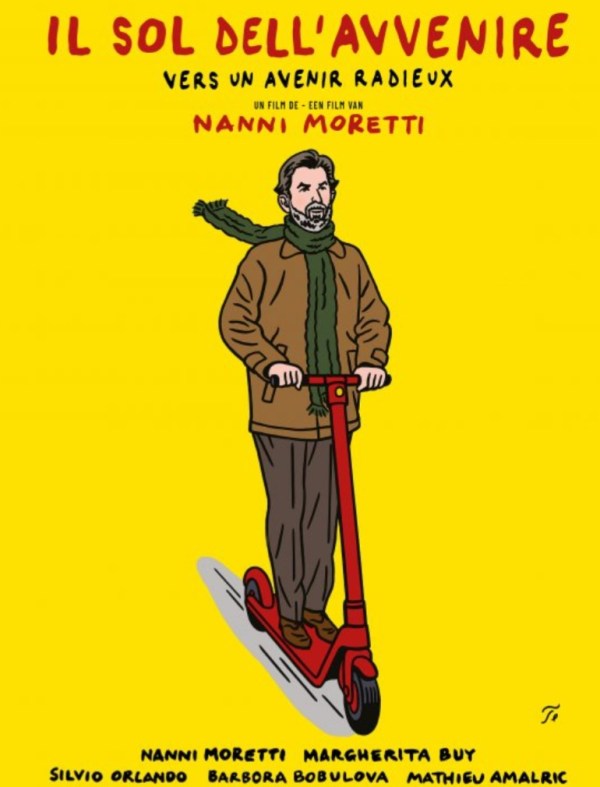Quand on devient familier d’un écrivain parce qu’on l’a lu depuis longtemps et régulièrement, fidèle au rythme et au style de ses publications, cette familiarité reste cependant quelque peu abstraite, comme celle d’un personnage un peu fantomatique qui vous accompagne sans que, comme lecteur, on puisse le connaitre vraiment. Et lorsque l’occasion se présente, c’est un peu comme si rencontrer le romancier, c’était aussi rencontrer un personnage de ses romans. Andreï Kourkov, romancier ukrainien de langue russe né près de Leningrad et citadin de Kiev, passant désormais à l’écriture en ukrainien notamment dans ses livres pour enfants, est un écrivain dont le personnage attachant confirme l’humanisme teinté d’une douce ironie qui émane de ses livres.
Lire la suite « L’humour au temps de la guerre, technique de survie »Le prototype du tyran autocrate ou Suétone lu par Roger Vailland
Un jour lointain, lycéen d’une douzaine d’années, je reçus, comme prix de version latine, un livre qui n’était pas tout à fait de mon âge, des extraits choisis de la chronique de Suétone, Les douze Césars, commentés par l’écrivain Roger Vailland, qui relataient en détail les mœurs et les vices des dits Césars. J’avais déjà eu l’occasion de travailler en classe de latin sur d’autres textes moins scabreux de Suétone, mais la lecture de ces extraits-là me déconcerta quelque peu, je montrai le livre à ma mère qui, horrifiée, voulut me l’arracher mais c’était mon prix et je le gardai rageusement. Je l’ai conservé précieusement jusqu’à aujourd’hui, le feuilletant parfois, et je viens de le relire exhaustivement. Peut-être parce qu’il contenait cet avertissement final de Roger Vailland : « Prudent Suétone. Il nous a quand même dit tout ce que nous devions savoir de nos futurs cauchemars ». Ce livre était-il arrivé dans mes mains par intention ou par inadvertance d’un responsable de la distribution des prix ? Je n’en saurai jamais rien… [texte en pdf téléchargeable –> ici]
Lire la suite « Le prototype du tyran autocrate ou Suétone lu par Roger Vailland »Californie, rêve et cauchemar
Alors que la toute proche élection présidentielle aux Etats-Unis suscite l’attention et la tension, en n’étant pas de l’ordre d’une possible alternance classique mais en exacerbant les fractures de la société américaine, voilà qu’un roman, de l’autrice française Nina Leger, jette un regard vif et acéré sur une part de cette réalité américaine, traversée de violents contrastes socio-géographiques, sa part californienne.
Lire la suite « Californie, rêve et cauchemar »Les voix d’Aube l’Oranaise
Kamel Daoud aime donner vie et voix aux absents, aux oubliés, et il le fait avec éloquence. Dans Meursault, contre-enquête (Babel, 2016), il redonnait une identité, une famille à l’Arabe assassiné dans « L’Etranger » de Camus. Dans Houris, il redonne langue et parole aux victimes de la décennie noire en Algérie, ces années 1990 qui virent la violence islamiste se déchainer dans le pays – des victimes qui, lorsqu’elles ont survécu, sont marquées au plus profond d’elles-mêmes par les exactions et les massacres de masse qu’elles ont vécues. Ce n’est pas un exercice littéraire innocent, car « la charte pour la paix et la réconciliation nationale », imposée par le pouvoir algérien en 2005, gage la stabilité institutionnelle du pays sur la prohibition de ce qu’elle appelle l’instrumentalisation, notamment par écrit, des « blessures de la tragédie nationale », sous peine d’en subir les conséquences pénales. Un exergue du roman le rappelle utilement, sans fard. Cette stabilité, depuis vingt-cinq ans, s’est construite au prix de l’absolution des bourreaux, du silence des victimes et du déni de leurs souffrances, de l’acceptation de l’emprise islamiste sur la vie civile. [texte en format pdf téléchargeable ici].
Lire la suite « Les voix d’Aube l’Oranaise »Introspection post-Brexit
La césure du Brexit incite visiblement des écrivains britanniques à une introspection romanesque remontant l’histoire du Royaume-Uni au cours des dernières décennies pour explorer le croisement du cours de cette histoire et de destins individuels et familiaux qui se jouent sur un espace plus vaste que l’île rattrapée par son atavisme insulaire. Un retour revigorant et réflexif sur le roman national.
Lire la suite « Introspection post-Brexit »Trois femmes en libre cavale
Un peu par hasard, j’ai lu ces trois romans à peu près au même moment. L’un, parce que cette histoire d’une parisienne artiste débarquant en solitaire dans un coin perdu de Bretagne pour y vivre m’intriguait (et je l’ai lue avant que le roman n’obtienne le prix Renaudot !) ; l’autre, parce que le livre m’a été offert et qu’en ce cas, je suis curieux de l’intention associée au cadeau (et je n’avais jamais rien lu de Lucy Fricke) ; le dernier, parce que j’ai un faible pour l’Amérique latine et le musée du quai Branly et que je dispose d’une petite collection de mini-huacos érotiques, copies bon marché des originaux se trouvant dans un musée de Lima – ces céramiques précolombiennes en forme de figurines animales ou humaines. Ces trois livres racontent des histoires qui, au premier degré, n’ont rien à voir entre elles. Et pourtant, le hasard de leur lecture rapprochée me fit ressortir d’autant plus leur trait commun : le destin de femmes qui s’émancipent, à leurs risques et périls, d’une trajectoire prédéterminée par leur propre histoire personnelle et son contexte relationnel et professionnel (version pdf de l’article téléchargeable ici).
Lire la suite « Trois femmes en libre cavale »Lohengrin, par Serebrennikov: la mort du romantisme
Comment transformer un opéra romantique du milieu du 19e siècle, qui célèbre le héros providentiel et messianique venu d’ailleurs, doté d’une supériorité quasi-divine, pour conduire le peuple au combat avant de renoncer, en une œuvre dénonçant la guerre de conquête, ses désastres humains et les troubles qu’elle engendre dans les esprits ? C’est le tour de force dialectique que réussit Kirill Serebrennikov – metteur en scène russe exilé et opposé à la guerre en Ukraine – dans sa mise en scène, à l’Opéra national de Paris, de « Lohengrin », opéra de Richard Wagner (en septembre et octobre 2023). Dans un parfait respect de la partition et du livret et une tenue magistrale de l’orchestre et des choeurs ! Mais en changeant, par l’adresse dans sa conduite du jeu des acteurs-chanteurs et des relations entre eux, l’angle de vue du spectateur sur cette histoire héritée de la vieille légende médiévale du Chevalier au cygne. Elsa, jeune femme de noble ascendance, traumatisée par la mort au combat de son frère, dont elle est tenue pour responsable, imagine la venue d’un sauveur providentiel, qui arrivera bien en la personne de Lohengrin et s’avérera un va-t-en-guerre versatile, à l’identité interdite, misant sur l’aura mystérieuse qui l’entoure, venu mobiliser les troupes blessées et résignées dans l’hôpital où Elsa est internée. Lorsque Wagner composa cet opéra en 1848, c’était encore un jeune homme adhérant au mouvement des révolutions démocratiques et nationalistes de l’époque, ce qui lui valut quelques ennuis. De l’eau a coulé sous les ponts depuis lors et, pour aller très vite, au cours des quasi-deux siècles qui ont suivi, le nationalisme s’est distancié de la démocratie pour prendre les couleurs revanchardes et impérialistes qu’on lui connait. Kirill Serebrennikov en prend acte et dévoile le sombre envers de la légende.
Lamento haïtien
En 2009, nous avions accueilli, dans la structure que j’animais alors, une jeune stagiaire haïtienne, brillante étudiante de master. Aux vacances d’hiver, elle repartit en Haïti et fut engloutie par le séisme du 12 janvier 2010, alors même qu’elle se rendait à l’institut culturel français. Une vie amorcée, effacée sans coup férir par le tremblement meurtrier.
Haïti, pays de souffrance… Eddy est un jeune homme, depuis peu employé prometteur de l’administration fiscale, épris de probité dans un pays où celle-ci est une prise de risque extrême. Il subit le séisme et lui survit mais ne s’en relève pas. Le roman de Guy Regis Jr, « L’homme qui n’arrête pas d’arrêter » (JC Lattès, 2023) est un long lamento qu’Eddy s’adresse, usant de la deuxième personne, à lui-même sur un mode solipsiste, se dissolvant entre ses addictions, s’égarant entre ses amours perdus, se réfugiant parfois auprès de sa vieille maman pour tromper sa solitude et tempérer son désespoir. Il devient un zombie objet de dérision. Et pourtant sa curiosité réveillée par la vision d’un jeune rappeur assassiné dans une rue de Port-au-Prince lui fait reprendre un fil de vie fragile, une envie de savoir, jusqu’à retrouver la voie de l’échange avec ses semblables et vivre une épiphanie amoureuse régénératrice. L’exhortation finale d’un vieux poète le fera s’extraire enfin de la malédiction du zombie et se réapproprier une parole salvatrice, désincarcérée : « Puisque des années et des années, sans répit, que vous côtoyez de plus près la mort, des années et des années que vous êtes considérés morts. Morts avec ces terribles tremblements de terre, morts avec ces hécatombes, morts avec ces catastrophes redondantes qui secouent, tourneboulent, ratiboisent tout en vous. Il ne vous reste plus que la parole obsédante, éternelle. Pour arrêter de penser sur la même misère infernale, mille fois la même chose ».
L’anti-nostalgie
« Vers un avenir radieux ? » La nostalgie est un sentiment ambivalent, qui peut virer à l’enfermement séducteur et complaisant, avec soi. Giovanni – Nanni Moretti en personne – est un cinéaste et un boomer à principes, au point d’être psychorigide avec son entourage familial et professionnel, ses acteurs, son épouse et collaboratrice historique, sa fille… Il connait son cinéma, fellinien notamment, sur le bout des doigts et n’hésite pas à faire la leçon démonstrative à un jeune collègue, du haut de ses quarante années de carrière. Il a d’ailleurs de bonnes raisons lorsqu’il démontre éloquemment, face à une scène d’exécution esthétiquement standardisée tournée par ce collègue, que la violence est montrable au cinéma si le spectateur est amené à en ressentir le caractère insupportable et saura donc s’en détourner. Mais son comportement de donneur de leçons insupporte et sombre dans la stérilité, tant il rejette hors de sa vue la vie qui ne colle pas à ses conceptions. C’est un boomer impénitent.
Giovanni tourne, aujourd’hui, un film sur l’impact, dans un quartier populaire de la banlieue romaine, de l’intervention soviétique de 1956 en Hongrie, alors même qu’un cirque hongrois vient de faire joyeusement son entrée dans le quartier. Les membres de l’active et influente section locale du parti communiste italien, et notamment sa charismatique secrétaire, se rebellent spontanément contre cette intervention mais se heurtent à la hiérarchie du parti, alors dirigé par Palmiro Togliatti. La tension monte au sein du couple amoureux formé par la secrétaire et un rédacteur de l’Unita, le quotidien du PCI.
Giovanni envisage une chute fatale du film, d’autant qu’il est lui-même déstabilisé par la déréliction de son couple et les péripéties de la production : son producteur français défaille et Netflix le traite comme un ringard. Le film est heureusement sauvé par la providence qu’incarnent de jeunes producteurs coréens, dégottés par l’encore épouse de Giovanni et trouvant sans doute exotique ce pan de l’histoire italienne et européenne. Dans un élan salvateur, Giovanni change la fin du film au dernier moment, en changeant l’histoire tout court. Le rédacteur, arbitrant en faveur de la solidarité amoureuse contre la loyauté partisane, se joint finalement à la rébellion et sort un numéro de l’Unita qui annonce la rupture avec Moscou. Une foule joyeuse et fière défile dans le quartier – à l’image du fameux tableau de Giuseppe Belliza « Il quarto stato » mobilisé par Bertolucci pour son film « 1900 ». Et Giovanni, enfin dénoué, part dans une danse avec ses acteurs et techniciens.
Et si on réécrivait librement l’histoire, pour faire de la nostalgie non pas un ressassement mais une réouverture des possibles ? La vie un peu comme un cirque, une prise de risques.




Ecrire la guerre
Quand les femmes et les hommes ordinaires sont plongés dans la guerre, que devient leur humanité, mise à l’épreuve ? La question n’est pas neuve et la littérature qui l’explore, au-delà des péripéties immédiates de la guerre pour dire comment cette dernière transforme les humains, n’est pas rare, mais la justesse de son regard est moins répandue. Si cette littérature a ses classiques, elle se renouvelle grâce à des écrivains contemporains, qui maîtrisent, chacun à leur façon, cette justesse du regard. Voici trois notules sur des romans parus en 2022.
Mathieu Belezi retrace, dans une langue aussi tragique que poétique, les tribulations de soldats français et d’apprentis colons aux premiers temps de la guerre de conquête coloniale de l’Algérie par la France, au milieu du 19e siècle. Tribulations cruelles, pour les autochtones et pour eux-mêmes, qui font osciller chacun de ces intrus en terre algérienne, venus « Attaquer la terre et le soleil », sur le fil du rasoir entre la damnation et le renoncement.
Andreï Kourkov fait revivre la Kiev de 1919, lorsque, au sortir de la première guerre mondiale, la ville est en proie aux imprévisibles et dangereux affrontements de la guerre civile entre rouges et blancs. Le destin de la ville hésite entre la tentative de république ukrainienne et l’appartenance au nouvel ensemble soviétique. Pris dans les affres de l’époque, deux jeunes gens, Samson et Nadejda, prennent le parti ou le pari soviétique, poussés par les circonstances autant que par leurs aspirations. Et avec son habituelle verve burlesque, Andréï Kourkov mêle au tragique du temps une drôle d’enquête policière qui emporte le lecteur dans les rues et les quartiers de Kiev. « L’oreille de Kiev » est aussi un hommage cartographique à la ville éprouvée.
La rencontre d’un style et d’une histoire me rend un roman spécialement attachant, quand l’histoire se coule dans le style, quand le style porte l’histoire, comme on voudra. Avec Alain Emery, on n’est pas déçu. Dans « Quatre rivières », des personnages rapidement mais densément esquissés, comme gravés sur les pages, se mettent à exister par la mémoire qu’ils trimballent et qui les hante, en l’occurrence celle de la grande guerre et de ses traumatismes, dont l’écho n’en finit pas de se propager des années après l’armistice. « La mémoire, quand on y pense, c’est une belle vacherie. Une vase malodorante et brune, grouillante de revenants et de cauchemars, où s’embourbent des lambeaux de souvenirs dont on peine à saisir le sens. Quand on patauge assez longtemps dans ce marécage, on finit parfois par s’y égarer. Tout le monde peut se perdre ». Alexandre, jeune chirurgien confronté aux horreurs du front, s’établit quelques années plus tard dans un bourg tranquille, cerné par ces rivières qui peuvent se révéler tumultueuses. Il pourrait prendre la voie assurée d’un notable de village, mais l’écho de la guerre lui revient en plein visage, finissant par le pousser à la fuite et à l’exil. Il y a quelque chose de Bardamu chez Alexandre, sans le cynisme cependant, un désespoir contenu qui entraine au bord de l’abîme, sans jamais renoncer pourtant à l’espérance d’un regain vital.
La guerre hante les survivants, dont les héritiers n’échappent pas, quand bien même ils tentent l’oubli, aux réminiscences de tous ordres. Aujourd’hui n’est pas hier mais, lorsque la guerre fait rage sur la terre d’Ukraine, il est bien qu’une littérature opère une juste mise à distance de la tourmente guerrière pour aider à mieux penser cet aujourd’hui.